Études et recherche en Sciences Humaines à Grenoble

Depuis des décennies, j'ai orienté mes études pour mieux connaître et comprendre l'être humain. Découvrez sur cette page les principales recherches que je mène. N'hésitez pas à me contacter pour toute demande.
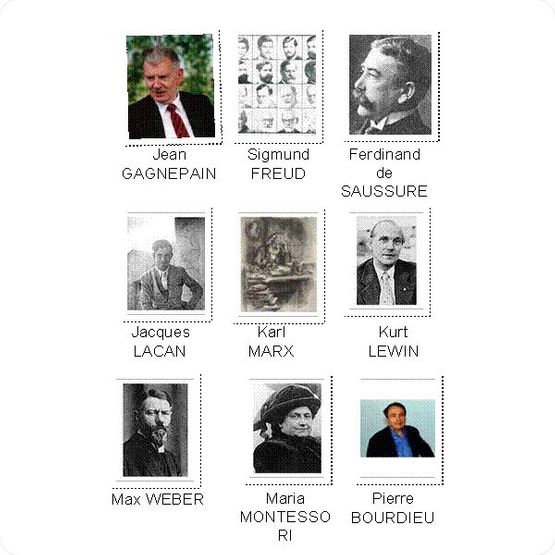
Mes influences
La galerie de portraits ci-jointe résume les influences des recherches que je mène depuis le début de ma formation. Ce qu’on appelle « psychologie » constitue un ensemble complexe dans le vaste champ des Sciences Humaines.
Une compréhension objective de l'humain
Pour approcher une compréhension plus objective de l’humain, je me suis intéressé à des approches anthropologiques complémentaires : linguistique, histoire, biologie, physiologie, psychiatrie, sociologie, ethnologie, éthologie…
CROIRE OU NE PAS CROIRE ?
CRISE DE LA CROYANCE OU SOIF DE CERTITUDE ?
Introduction
Croire en quelque chose étant une certitude plus ou moins grande par laquelle l'esprit admet la vérité ou la réalité de quelque chose, c’est toute l’histoire des démarches scientifiques et des sentiers de la connaissance qui permet d’affirmer des certitudes (des nécessités plutôt que des hasard). L’esprit scientifique étant de plus en plus confondu avec le positivisme, certaines croyances deviennent de plus en plus facultatives ou soumises au caprice et à la toute puissance de l’opinion.
En sciences humaines la contingence, soumise aux statistiques, est très souvent considérée comme la loi scientifique fondamentale de l’espèce humaine. Cette contingence est-elle un hasard ou une nécessité au même niveau que les fonctions biologiques ? La contingence serait alors facultative par rapport à des fonctions naturelles ? Dans les relations humaines la fonction (ou la faculté) de tiers a toujours été considérée comme plus ou moins nécessaire (fonctionnelle) ou facultative selon les conceptions plutôt rationalistes (optimistes) ou plutôt empiriste (sceptiques) ?
Par exemple, si la fonction paternelle (nécessité rationnelle) a la même nécessité que la fonction maternelle (nécessité empirique) dans la conception de l’enfant, la nécessité parentale implique une conjuration du hasard parental différent du hasard génital car il n’est pas scientifique de découper la nécessité (fonction) sans découper en même temps le hasard (facultatif). Autrement dit, parler du hasard comme d’une croyance, providentielle ou pas, comme d'une sorte d’en-soi philosophique - fût-il fugace - cela représente une absurdité. Une absurdité rationnelle qui empêche de poser clairement la problématique de l'humain. Le hasard existe-t-il?
La raison distingue quatre principes rationnels donc quatre nécessités et quatre hasards:
la causalité s'oppose à l’absurde
la sécurité s'oppose à l’accident
la légalité s'oppose à la contingence
la légitimité s’oppose à la lubie, au caprice, à l’envie
Décomposer la nécessité rationnelle, c'est donc décomposer le hasard vécu par rapport à la nécessité empirique. L’absurdité d’un événement inattendu, l’accident, la contingence, est à mettre en rapport avec un désir ou un non souhait (contrariété). La quête de nécessité que nous envisageons ici consiste surtout à mettre chaque nécessités - y compris la légitimité - dans une situation dialectiquement contradictoire. Cela signifie qu’admettre d’un coté la rationalité (en philosophie) et de l’autre le problème de la valeur et du désir (empirique en psychologie), est absurde. Absurde dans la mesure où la valeur (le désir) est aussi rationnelle que la seule connaissance ou représentation (Hegel). La question de la reconnaissance ou de l’acceptation (Un fait) est une même nécessité qui recoupe la totalité de la culture et n’est pas seulement une question naturelle (positive) de vérité.
Cela ne signifie pas que la vérité et la fausseté d’un événement n'aient pas à retrouver un statut, mais cela signifie que ce n'est qu'un aspect particulier du point de vue de la connaissance d'un problème beaucoup plus vaste qui est celui de l'antagonisme de l'erreur et de la certitude. Erreur et certitude étant liées à toutes les modalités humaine.
Le vaste problème du fait que c’est l’homme lui-même qui finalise le monde, et fournit toujours la preuve selon les critères retenus, physiques, biologiques ou culturels, complexifie la question du Status de l’événement (un accident, une naissance, un virus, une maladie, une faute…) qui ne peut pas être considéré seulement positivement. Nous ne pouvons pas sortir du doute qui oppose à l'erreur la certitude sans un quelque chose en plus qui nous rassure sur notre croyance.
Dans une première partie nous essayerons de poser le problème de l’antagonisme du déterminisme et de la fatalité. Ensuite nous envisagerons la question du principe de réalité. Enfin nous verrons comment l’incertitude peut être source de joie de vivre.
Partie I
DU DÉTERMINISME OU DE LA FATALITÉ
a) Les deux visages du rationalisme
Toute la pensée philosophique traditionnelle, quel que soit le contenu de ses affirmations, même avant la querelle induction/déduction, a en commun de viser la certitude. Une certitude positive ou négative, mais une certitude tout de même. Respecter la tradition philosophique c’est distinguer les rationalistes et les empiristes. Les rationalistes ont tendance à affirmer la possibilité d'obtenir une quelconque certitude (le réel), tandis que les empiristes au contraire s'enferment dans une espèce de doute (factuel) dont ils posent les fondements comme certains. Ils affirment qu’il n’y aura jamais de certitude. Rationaliste et empiristes ont ainsi en commun une même affirmation et partagent une même certitude. C’était déjà ce que Sextus Empiricus au deuxième siècle après Jésus-Christ expliquait : parmi les médecins de son temps il y avait les logikoi et les empeirikoi, C ‘est à dire, les rationalistes et les empiristes. Cet antagonisme est donc une posture de pensée très ancienne.
Dans la distinction des quatre principes rationnels qui créent la nécessité, posés en introduction, la causalité (qui s'oppose à l’absurde) et la légalité (qui s’oppose à la contingence) sont plutôt des “façons de parler“ (logique), alors que la sécurité (opposé à l’accident) et la légitimité (opposée au caprice) sont surtout des manières d’agir (pragma).
La dichotomie logique/pragma est un vieux problème philosophique (théorie et pratique) qui essaie de dissocier le déterminisme et la fatalité. C’est pourtant un faux problème car "parler" et "agir" ne s'opposent pas véritablement, ce sont deux conceptions de la certitude. Un même rationalisme se trouve donc à la base du déterminisme causal ou légal ou bien de la fatalité sécuritaire ou légitime.
Les nécessité causales et légales (très verbales) sont généralement qualifiées de déterminismes dogmatiques et les nécessités sécuritaire et légitimes (l’action) sont qualifiées de fataliste et empiriste. Cette dualité représente les deux grandes écoles rationalistes qui ont marqué la pensée jusqu'à présent. D'un côté, les rationalistes dogmatiques, Descartes, Leibniz, Spinoza, de l’autre le rationalisme de type empirique avec Francis Bacon, Locke, Hume, Condillac. Ces deux écoles représentent les deux grands aspects d'un seul et même rationalisme.
On peut aussi distinguer les déterministes (rationalistes) des fatalistes (empiristes) comme le faisait Leibniz: d'un côté les optimistes (rationalistes) et de l'autre les pessimistes (empiristes). Mais optimistes (la vérité) et pessimistes (les faits) croient à la même chose puisque les pessimistes n'arrivent pas à faire le deuil de ce à quoi les autres croient. Et c'est pourquoi l’empiriste désespère là où le rationaliste y croit ! Et nous ne désespérons jamais que de ce que nous avons trop espéré (consciemment ou non)!
Considérons d'abord les optimistes (croyance en la vérité), cette posture correspond à l’entéléchie d'Aristote qui signifie "accomplissement" (l’achievement pour les anglais). Pour les optimistes, tout s’explique soit par la science soit par le mythe dans un monde où tout va ou bien tout ira pour le mieux. Les lendemains qui chantent s'inscrivent dans cette perspective d’un rationalisme optimiste, tout s'explique ou s'expliquera; tout va bien ou ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. C’est aussi l’optimisme de Leibniz, un optimisme partagé par la plupart des personnes qui croient en l'avenir de la science, de l’intelligence, l'avenir d’une reconnaissance, même à titre posthume. Pour les optimistes tout finira bien par s’arranger. Dans ce monde-là, même si la justice n'est pas immanente, il y a toujours moyen d'être honnête: c'est la probité, l'honnêteté maçonnique dans la république qui tient lieu de “l’idéal du moi“ du citoyen. Ces gens-là "font confiance à l'homme".
Donc d'un côté les optimistes (rationalistes) partisans de l'entéléchie et de l'autre les pessimistes (empiristes) partisans de ce que les Grecs appelaient l'anankè. Cette forme de nécessité qui est une fatalité proche de la morbidité. L’anankè est le rêve déchu d'une entéléchie. L’incapacité d’accéder à la perfection rêvée entraîne une forme de désespoir et il n’est possible de souffrir que d'avoir espéré; le dés-espoir ou le pessimisme c’est l'espoir à l’envers, d’où l’inquiétude des pessimistes qui croient à la même chose que les optimistes. Ils souffrent parce qu’ils sont désenchantés mais ils voudraient être ré-enchantés.
Ce courant qui se veut réaliste, fait référence à une conception de l'être humain réduit à l'illusion des sens. C’est le sensualisme de Condillac dans l’école empirique qui réduit l’être humain à l'illusion des sens (soumis à la douleur ou au plaisir) dans un monde absurde voué à toutes les apocalypses (la collapsologie). La fin du monde est conçue comme une catastrophe ou comme une peur panique devant tous les progrès. C’est aussi la justification d'un complet immoralisme au nom de la recherche de l’acte gratuit et de la liberté.
Le besoin de certitude des optimistes comme celui des pessimistes, des dogmatiques comme des empiristes, interdit le doute et le deuil d’une certitude qui fait souffrir.
b) Une société maniaco-dépressive (bi-polaire)
Ces deux écoles de pensée avec une même conception de l'erreur et de la certitude - la certitude étant ce qui gomme l’erreur - rendent l’époque actuelle invivable parce que l’opinion sent bien que tout bouge et que tout est en mutation actuellement y compris ce que l’on cherche à nous faire croire. La prétention savante de notre époque aboutit à ce qu’on peut appeler une société maniaco-dépressive (voir bi-polaire), c’est-à-dire une société qui se coupe strictement en deux en un clivage à l’égard du monde qui va venir.
Le désespoir des conservateurs comme celui des progressistes représentent un même aspect du principe hédonique de plaisir. Pour les uns comme pour les autres il n’y a pas de doute: il y a une certitude concevable et accessible, ou bien il n'y a rien ! Mais savoir qu'il n'y a rien, c'est encore savoir qu'il y a quelque chose, puisque ce n'est rien et ce rien est réifié.
Puisque d’une part on pense qu'il suffit d'y croire pour que ça change, ou bien de l’autre qu’il est vain d’espérer d’avance, donc, il n'y a rien à faire pour être cru puisqu'il n'y a rien à croire. On comprend alors, comment se répartit l'ensemble du monde “cultivé“ : d'un côté les sophistes au sens strict du terme qui s’acharnent à se faire reconnaitre comme crédibles sans aucune réalité (la foi gratuite); de l’autre les “réalistes“ qui jouent avec une certitude ludique (théorie des jeux) mais qui jouent avec le doute : ce sont les sceptiques. Le scepticisme (propre à la pensée scientifique) n'est pas un véritable rationalisme, ou plus exactement c'est précisément ce moment du rationalisme empirique où la raison doute d'elle-même et cultive le doute par jeu. Les sceptiques sont toujours des personnes qui jouent avec le paradoxe car on ne peut jamais rien prouver et il y a jouissance du doute par impuissance à trancher (l’hypocrisie).
Le doute actuel dans l’opinion est analogue à la posture rencontrée envers l’art et l’artiste contesté par l’incrédule ou le casseur : Puisque cette création est un mensonge ou une supercherie - on peut peindre avec la queue d'un âne - donc pourquoi ne pas casser, et dénier l’oeuvre ? Le casseur (mécréant, iconoclaste) est à l'artiste ce que le sceptique est au sophiste.
Socialement le dilettante perçu comme un rusé “filou“ s’oppose à l’esthète. L’esthète d’un côté, c'est-à-dire celui qui joue avec toutes les conventions sociales et de l’autre côté celui qui les nie toutes et qui se met hors la loi.
Moralement, Il y a le héros qui cherche l’exploit et d’autre part le salaud (Sartre). Celui-là est le type qui ne respecte aucune valeur, mais qui cultive l’immoralisme par plaisir. Ces deux aspect opposés dans l’opinion correspondent à deux figures littéraires représentants de la civilisation bi-polaire: Malraux d'un côté et Gide de l'autre.
Cette bi-polarité s’exprime aussi dans la manière de gouverner: d’un côté les terroristes ou radicaux et de l’autre des pitres tout aussi impuissants. S’il y a tant de problèmes avec les terroristes c’est parce qu'il n'y a plus de véritables hommes d’État (1/3 état). Les représentants n'y croient plus eux-mêmes mais ils veulent pourtant garder le pouvoir parce qu’ils en vivent. La politique politicienne avec le vide politique s’oppose à la politique des casseurs nihilistes (anarchistes), qui font exister le néant.
L’enjeu de notre société est de trouver un véritable tiers entre “le diable au corps“ et “la mort aux trousses", inventer un autre mode de “vivre-ensemble" entre croyants et sceptiques dans ce nouveau monde dont nous sommes responsables mais auquel nous avons finit par ne plus croire parce que "Dieu est mort".
Pourtant nous sommes sur terre simplement pour être (ni bien, ni mal). Mais l’impression ressentie considère soit que notre destin est pour après ou bien que c'est depuis longtemps passé et que nous ne sommes jamais que les enjeux d'un destin qui se joue sans nous. Il règne de plus en plus une posture de hasard qui nous pose comme l'enjeu d'une chance et d'une malchance, d'un bonheur et d'un malheur (un fast ou un néfaste). Notre société ne fait plus que privilégier la chance ou le vertige de la mort: le pari ou le suicide. Pour ne plus craindre la mort, le suicidaire la vit.
Il y a un développement fantastique des jeux de hasard ou du suicide dans la bi-polarité qui signe le rationalisme inhérent à la pensée qui nous précède. Il y a un rapport profond du jeu et de la mort. L’absence doit nécessairement être un contenu.
c) Du Bon Dieu à la mort de Dieu
La crise de la croyance et le doute généralisé s’exprime de la même manière chez ceux qui ont une croyance religieuse car il existe deux aspects fondamentalement différents de la même option religieuse: d'un côté il y a le théisme (opposé à l’athéisme, Dieu régit l'univers directement), de l'autre le messianisme (un messie viendra affranchir les hommes).
Si l’on considère par exemple l'Église chrétienne, il y a d'un côté les catholiques qui croient en un Dieu de miséricorde avec lequel il est toujours possible de s’arranger (papa-poule) et de l’autre, les protestants avec la prédestination très sérieuse et triste (père-fouettard). Dans le monde musulman s’exprime la même bi-polarité: les sunnites optimistes et les chiites pessimistes.
L’opposition d’une paternité divine optimiste ou pessimiste existe quelle que soit le contenu religieux. Chez les catholique d'un côté, les Jésuites pour qui tout s'arrange toujours grâce à la casuistique et de l'autre les Jansénistes qui sont quasi protestants (cf. Les Provinciales de Pascal). C'est en milieu protestant que s'est développée cette théologie très nietzschéenne de la mort de Dieu.
De la même manière il y a le laïcisme contre l’athéisme. D’un côté le laïque « qui a perdu la foi » mais qui n'est pas nécessairement athée et de l’autre l’athée très angoissé qui en veut à Dieu de ne pas exister. L’athéisme est un rêve déçu avec le deuil de Dieu qui n'en finit pas de s’exprimer. Ainsi l’athéisme de Karl Marx est profondément religieux et il est passé du paradis terrestre aux damnés de la terre. Il est passé du capital au communisme comme on passe du péché originel à la communion des saints.
Mais comme pour Marx, le problème actuel des croyances c’est qu'il n'y a plus de ciel, ni d'enfer non plus. L’athée qui est contre toute perspective religieuse, ressent une sorte de dépit amoureux qui contraint l'homme à se prendre en main, par défaut.
Le phénomène religieux est un phénomène humain - que l’on l’accepte ou pas - mais au nom du principe de réalité laïque d’origine théiste ou athéiste c’est un phénomène totalement négligé qui conduit à l’explosion des intégrismes ou des fanatismes actuels (gilets jaunes, extrême droite, extrême gauche, Hezbollah, Talibans, école libre, Zemour…). Le laïcisme actuel conduit aussi à une sorte de religiosité diffuse propice aux apparitions !
Partie II
LE PRINCIPE DE RÉALITÉ
Comment sortir de ces antagonismes excessifs et bi-polaires ? Il faut sortir de cette ambiguïté des deux visages du rationalisme évoqués dans la première partie et tenir compte d’un principe de réalité qui n’accrédite ni ne s’oppose à un principe de plaisir.
a) Le problème de la référence
En se posant le problème d’accès à la certitude, nous cherchons toujours à savoir si notre manière de la regarder correspond bien à l'original. Or si nous posons l'original, c’est que la question est déjà résolue puisque le monde existe indépendamment de nous. C’est là tout le problème de la référence.
Le problème de la référence est faussé par l’identification de la raison au verbe, c’est-à-dire l’identification du problème de la certitude ou de l’erreur à un problème de connaissance. C’est pourquoi la référence est toujours confondue avec l’objet. Or tout l’avantage d’un modèle comme celui de la théorie de la médiation, c’est de poser la référence, déductivement, sur les quatre principes rationnels évoqués en introduction : causalité, sécurité, légalité et légitimité. Ces quatre principes ou références n’ont rien de spécifiquement humains car ils correspondent aux fonctions naturelles (animales, neurologiques) que sont la gnosie, la praxie, la Somasie et la boulie: la causalité est un rapport à la gnosie, la sécurité/la praxie, la légalité/la somasie et la légitimité/la boulie.
Par exemple concernant la fonction somatique et la faculté légale, il est naïf de poser le problème du corps (en biologie ou en psychologie) pour ensuite le replacer dans son environnement (en sociologie, géographie, histoire), comme si l'un pouvait être préalable à l'autre. Or nous n'avons que le corps de notre environnement et que l'environnement de notre corps, c’est le sujet.
S'il n'y a pas moyen de confondre la référence (la personne) avec l’objet (le sujet), c'est parce qu’au simple niveau gestaltique (perceptif), toute question de référence mise à part, l'animal objective (gnosiquement), trajective (praxiquement), subjective (somatiquement) et projective (bouliquement) le monde. C’est déjà une restriction par rapport au vivant car le végétal ne le fait pas.
La liaison d’opposition binaire traditionnellement faite entre l’objet et le sujet (l’objectivation et la subjectivation) est très dangereuse car cette liaison a ontocentré les choses. il n'y a aucune raison d'établir une relation spéciale entre le monde (universel) - que l'on baptise objet - et le sujet qui est supposé avoir l'expérience du monde. Notre accès aux choses est toujours un rapport et nous n’avons, pas plus que l’animal, de mode d’appréhension très philosophique d’un en-soi quelconque, de nous-même ou du reste.
Une conception scientifique de l’homme et de la référence passe véritablement par un refus de tout substantialisme. Berkeley qui a été ridiculisé pour son idéalisme (immatérialisme) avait déjà perçu que Être, c'est être perçu ou percevoir. cela veut dire qu'il n'y a pas de sujet sans expérience mais qu'il n'y a pas non plus d'expérience sans sujet. La juxtaposition de deux en-soi ne pouvait aboutir qu'à deux entités qui ne pouvaient absolument pas se réconcilier étant donné qu'elles avaient été artificiellement mises dans des équations qui ne se réalisent absolument pas dans l'observation de ce que nous sommes.
Avec la quête de scientificité en sciences humaines (et avec la théorie de la médiation), un autre rapport au monde - moins simple que celui de la tradition philosophique et Berkeley - est conçu. La référence n’est pas un “en-soi“ de même que la structure n'est pas un autre univers formel mais une pure négation, et le référent n'est qu'un pôle dialectique. Le référent n'a pas d'autre existence que tendancielle. Le rapport de la structure et de la référence est un rapport contradictoire: il y a un rapport d'évidement et un rapport de réinvestissement.
Au niveau de la gnosie, de la connaissance et de la causalité logique du raisonnement, le concept est la transformation du percept. Cette transformation en concept ne peut se faire que par l’évidement du percept réalisé dans la structure. L’évidement se réinvesti dans du concept au lieu du percept. Cette explication montre que le rapport créant la référence est infiniment plus complexe parce qu'on la saisit cette fois non pas comme une opposition d'en-soi(s) mais comme une contradiction dialectique. Autrement dit, la référence n'est rien d'autre qu'un pôle au même titre que la structure et ni l'un ni l'autre n'a de réalité physique; la référence n'est pas plus matérielle que la structure n'est spirituelle. il s'agit d'un rapport contradictoire entre un pôle qui évide et un autre pôle par rapport auquel l'investissement se trouve toujours en asymptote. Il y a du vide partout, mais il n'est pas vectorisé, dans le cadre de la contradiction dialectique, de la même façon. Comme nous avons une conception trop substantialiste des choses nous donnons à l’objet une dimension de résistance de la référence qui crée ce que l’on appelle le réalisme. Mais d’autre part, pour la structure, en lui donnant une dimension substantialiste cela crée le formalisme. Or réalisme ou formalisme dans une pensée dialectique se trouvent être ensemble rejetés et condamnés. il faut envisager comme une dialectique ce qui est déjà un rapport.
Cette réflexion sur la référence dialectique nous oblige à réfléchir sur le concept de contradiction qui n’est pas une opposition. La résistance toujours en oeuvre, fait qu'il ne peut, scientifiquement y avoir de réel que construit. Ainsi, pour le monde que nous avons à dire (gnosie), à faire (praxie), à être (Somasie) ou à vouloir (boulie), la référence est un principe de résistance qui est principe de réalité. Contrairement au principe de plaisir qui est enjeu dans la douleur, le principe de réalité résiste à nos efforts conceptuels et c’est ce sur quoi nous achoppons, car le réel résiste à nos croyances.
Pour illustrer cette conception de la référence comme principe de réalité, analysons le mouvement actuel des « antivax ». Est-ce ou non une posture politique ? En fait c’est un soulèvement social et il est inutile de demander un avis sur la vaccination elle-même car ceux qui se retrouvent dans ce mouvement social ne seront jamais d’accord entre-eux (comme pour les gilets jaunes). Ils ne sont simplement pas d’accord avec le maquignonnage de la politique menée. Ils ne veulent pas entrer dans les manoeuvres d’une politique car ce n'est pas au niveau des revendications explicites que le problème se pose: il y a autre chose. En tant que principe de réalité, ils ne peuvent qu'être contre et ce qu'ils expriment ainsi, c'est le malaise d'une société qui ne trouve plus de référence. A ce moment-là, ils font la politique en négatif et aucune décision, décret, changement de décisionnaire de droite ou de gauche ne changera la situation. il faut simplement en prendre conscience et c'est là que se vit, se fait, la politique comme principe de résistance et principe de réalité.
Il n’est pas possible d’échapper à ce problème de la référence que j’évoque ici avec toute son ampleur pour tenter de sortir des analyses trop étroites qui cherchent des recettes immédiates.
b) L'impasse du positivisme (héritage du criticisme, loi des trois états, pragmatisme)
Depuis le XVIIIè et le XIXè siècle notamment, il y a eu de nombreux essais de résolution, entre ces principes de plaisir toujours insatisfaisants et le principe de réalité sur lequel nous nous heurtons. Comment faire pour trouver une certitude ? Examinons d’abord le criticisme puis la loi des trois états et enfin le pragmatisme. Ce sont trois explication du positivisme.
Kant, avec ses raisonnements critiques (criticisme) (raison pure, raison pratique et faculté de juger), avait séparé en deux le problème de la certitude, en mettant d’un côté ce qui est accessible et de l’autre ce qui est inaccessible: il considérait qu’un certain nombre de choses pouvaient être certaines, il les nommait « phénomènes » ; et il considérait aussi un certain nombre de choses dont on ne pouvait pas être certain mais que l'on était obligé de postuler car c’était “au-delà“, comme notamment la question de l‘être. Il a appelé cette autre réalité « noumène ».
Cet héritage du criticisme de Kant a été repris par Emile Littré qui était un disciple de Auguste COMTE et affirmait à la suite de Kant que tout ce qui était accessible à la Vernunft était de l'ordre du noumen (l’incertain) pour lequel il n’est pas possible de prendre parti. Il se débarrassait ainsi du problème du rapport au savoir en disant que l'on était dans une circularité totale, bloqués en nous-mêmes et condamnés à l’ambiguïté : ce dont on ne peut pas être certain (les croyances), il le mettait “au-dessus“, dans le ciel ou au-delà; et le savoir dont on était certain (qui relève du Verstand, les phénomènes), c’est ce dont on peut avoir l'expérience (sensible ou autre).
Son maître Auguste COMTE a procédé autrement, afin de graduer la certitude il a inventé la loi des trois états. Dans une période où l’histoire triomphait, il n’a pas superposé hiérarchiquement deux univers certain et incertain, mais il a posé le savoir dans une évolution historique. Il a posé le mythe comme antérieur à la science en assimilant mythe et religion créant les trois états du savoir: théologique, métaphysique et scientifique.
La conception évolutionniste du savoir et notamment de la hiérarchisation temporelle de la pensée mythique par rapport à la pensée scientifique donne un statut temporel différent à des processus de pensée qui ont une égale importance dans l'élaboration rhétorique du savoir. La conception évolutionniste d’Auguste Comte avec des stades prélogiques à la pensée pour essayer de graduer l’incertitude et la certitude pose ainsi l’incertitude dans le passé et la certitude dans le présent. Cette conception naïve du savoir informe encore aujourd’hui les écoles primaires, secondaires et universitaires et le comtisme est encore à la base de l'enseignement dispensé.
Cette pensée évolutionniste implique que l’on soit passé d’un art magique vers un art empirique qui empêche de comprendre les gadgets contemporains; d’autre part que l’humanité aurait été l'esclave d’une morale ascétique “avant“ et que la morale hédoniste est plus moderne. Du point de vue politique les convictions sur la droite sont assimilée à l’ancien régime conservateur et la gauche à l’avenir, au progrès ou a l’utopie. Pourtant Il n'y a pas de raison de situer la droite toujours avant et la gauche toujours dans le sens du progrès. A toute époque, il y a toujours plus à gauche que soi et nous sommes toujours à droite de quelqu’un. Une vision positive de l’histoire ne mène à rien.
Enfin la troisième voie du positivisme qu’est le pragmatisme ne croit ni en Kant ni à Comte. Les pragmatiques, quelques soient les différences, recherchent l’entente. « Puisqu'on ne peut pas hiérarchiser le certain/incertain ni les rendre successifs, il faut apprendre à vivre ensemble ». En politique nous reconnaissons là les techniques modernes et sans espoir des deux moitiés démocratiques de la droite et de la gauche évoquées précédemment, qui entrainent l’alternance plus ou moins maniaco-dépressive.
Le pragmatisme a été inventé en Angleterre et la démocratie anglaise est prise pour un exemple. Son pragmatisme répond à une hypocrisie profonde (la perfide Albion) et il y a longtemps que les britanniques pratiquent l’alternance pour contenter tout le monde et c'est toujours la Reine qui lit le discours final. Ce système sécurise les Anglais parce que la reine y met un ton de certitude dans deux discours contradictoires, aussi inadaptés l'un que l'autre. Ce pragmatisme crée un lieu édénique de rencontre maintenu par une pseudo croyance en la divinité royale.
Le même pragmatisme tente d’être reproduit en France avec le mécanisme de la cohabitation. Cet état est vécu de plusieurs manières: Une hiérarchie un peu kantienne avec le président inaccessible et le premier ministre comme fusible sensible. De l’autre les comités réunissant des gens de bonne volonté de toutes obédience. La bonne volonté est un moyen pragmatique d’existence mais ne peut pas constituer une véritable réalité d’entente commune.
L’hypocrisie britannique ne peut pas marcher en France parce que ce pays à coupé la tête du droit divin. Il devient urgent d’inventer autre chose que la démocratie pour permettre à tous de vivre ensemble. Chacun pourtant se sens obligé de se dire démocrate parce qu’on n’a pas trouvé autre chose. Cette affirmation hypocrite est un moyen de durer mais ce moyen ne peut être ni le criticisme, ni la loi des trois états, ni le pragmatisme de l’alternance ou de la cohabitation.
c) L’Autre, c'est soi-même
Après avoir fait le tableau de la référence et l'avoir située dans le cadre de la contradiction dialectique, après avoir fait le tour de l'impasse positiviste, nous sommes bien obligé de considérer le problème de l’opposition du certain au moins certain, du rationnel et de l'irrationnel, comme une problématique qui n'existe que parce que nous la posons. Nous sommes à un moment de la société qui cherche à sortir de l’enfance pour qui le responsable c’est toujours l’Autre. C’est une période de révélation et de découverte du principe de réalité où l'humanité se compare à un seul homme.
Nous sommes en train de découvrir socialement, dans cette double phase maniaco-dépressive que finalement le problème, c'est nous qui le posons et que si nous avons à le résoudre, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Nous vivons une période de révélation où nous ne pouvons être ni totalement altruiste ni totalement égoÏste car l’Autre c’est nous aussi. Tant que nous restons enfant (irresponsable) nous pouvons rester naïf et pouvons continuer à croire à la providence ou le don excède la demande. Alors comment réussir à continuer à demander lorsque nous sommes gavé ? Car l’excès du don par rapport à la demande maintient la croyance.
Le résultat de la révélation que “l’autre c’est moi“ entraine une déception ou un désenchantement (cf. Note 16) qui peut, éventuellement, faire chuter la libido (Principe de plaisir) ! Mais c’est surtout un processus de responsabilisation nécessaire qui est l’amorce d’un au-delà d’un principe de plaisir. C’est là où se situe le cheminement vers la “paternité symbolique“ développée par la psychanalyse. Avec ce concept, il s’agit d'une autre paternité que celle qui est uniquement génitale et qui est même ensuite sociale. Il y a là une sorte de catharsis du concept de paternité (être pour l’Autre et être avec l'autre) qui doit être étendue aussi bien au problème de la parentalité qu’à celui du patronat, du métier et même à celui du gouvernement. Pour les professionnels de l’éducation, la rationalité du principe de paternité, et du “l’autre c’est moi“, constitue tout le programme de l'Éducation nationale car l’échange particulier du service à rendre est d'emblée dans l'éducation comme dans le rapport parental. Pour rester pertinent un certain temps dans cette relation de paternité ou relation à “l’Autre moi-même“, il faut que ce que le professionnel apporte à celui qu'il forme dépasse la demande, comme dans l’ “objet a“ de Jacques Lacan. C’est exactement là où réside l’échec (sinon le crime) des prêtres pédophiles dans l’église chrétienne.
Si les parents n’ont comme fonction que de répondre aux besoins de l’enfant pour les placer socialement, c’est les rendre esclaves à reproduire le modèle que nous sommes supposés être. La jeunesse est effectivement porteuse du principe de réalité à condition qu’elle ne reproduise pas la société antérieure. Car le monde est toujours à faire au-delà de l'espoir de lendemains très incertains ou bien d'une décadence irrémédiable Le seul service que l’on peut apporter à la jeunesse, c'est de l’amener à se passer de nous pour qu’ils adviennent eux-même au principe de réalité.
Partie III
HYMNE A LA JOIE
Après avoir opposé un principe de réalité responsable à une fatalité ou a un déterminisme qui semblaient s’imposer, la faillibilité peut devenir enthousiasmante. Le principe de plaisir ne s’oppose pas au principe de réalité et la responsabilité peut trouver du plaisir et de l’espoir sans irresponsabilité. Pour créer la perspective d’une permanente renaissance et gérer l’angoisse existentielle associée à la responsabilité de plus en plus grande et à l’incertitude, certains principes sont nécessaires.
a) Eloge de l’incertitude
Avec l’approche de la rationalité comme nous tentons de le faire, il n’est plus possible d’opposer le rationnel et l’irrationnel puisque le hasard comme l’irrationnel n’existe que pour la raison et seulement pour l’espèce humaine. l'irrationalité ou l'absurdité du monde ne sont absurdes que pour celui qui cherche à y mettre, plus ou moins implicitement, quelque clarté causale. Donc, l'irrationnel fait partie du rationnel et l'irrationnel est raisonnable.
Beaucoup de savants ont aperçu ce paradoxe de la rationalité: déjà Leibniz et surtout Hegel qui a souvent été compris naïvement avec son "ce qui est rationnel est réel et ce qui et réel est rationnel“. Et plus récemment Heisenberg et Meyerson. Tous ces savants avaient bien senti que le rationnel posait le problème de l’irrationalité. Leur erreur était d’inclure tout le problème de la certitude dans l’humain globalement à partir de cette question. Ce qu’il faut retenir c’est que même l'irrationnel fait partie du rationnel dans la mesure où cela représente dialectiquement l’antagonisme.
Autrefois (avant les sciences humaines) lorsque le raisonnement scientifique ne s’intéressait qu’à la matière, la question de l’irrationnel était négligeable puisqu'il n'y avait que l'aspect rationnel qui était formulable en propositions définies. Le reste demeurait le domaine du mythe, voir de l’illusion. Mais si nous voulons réellement faire des sciences humaines où l’humain n'est pas sur la scène mais dans les coulisses, où l’homme est observé en train d’opérer sachant qu'il nominalise et finalise le monde, alors nous ne pouvons plus être dupe du fait que non seulement nous avons à résoudre le problème, mais que pour expliquer l'homme il faut expliquer comment l'homme pose le problème. Le problème est donc ici précisément de saisir la contradiction dialectique de la tukhè et de la ratio, du hasard et de la nécessité.
Si l’on prend au sérieux la dialectique, la croyance et la certitude ne font qu’un car l'une n'est que l'absence de l'autre, c’est-à-dire que c'est le problème qu'on se fournit à soi-même à résoudre. Le “raisonnable irrationnel“ peut paraitre contradictoire mais les sciences humaines ne peuvent plus l’éluder car l'observateur et l'expérimentateur sont dans la coulisse (l’inconscient) et non pas seulement sur la scène. L‘homme est celui qui résout les problèmes qu’il se pose lui-même et il prend conscience qu'il ne peut plus compter que sur lui-même. Il est l'auteur de la souffrance qu'il s’impose, y compris en acceptant ou en refusant la sujétion par exemple. L’homme, qu’il le veuille ou non, est responsable même de sa sujétion dans la mesure où il s'en fait complice en l’acceptant.
Il est évidemment difficile de se délivrer de la croyance ou de l’incertitude et c’est le sens de ce que la phénoménologie appelle l’angoisse existentielle interprétée notamment par la philosophie existentialiste de Sartre, Beauvoir et Camus. Cette démarche est cependant nécessaire pour réussir à accepter la responsabilité de la totalité de son destin. L’angoisse est précisément la conscience de la circularité de la question qui, faisant que nous posons le problème en même temps que nous le résolvons, fait qu'il n'y a pas de preuve pour nous en sortir. Nous sommes d'une certaine manière condamné à l'inquiétude. Si c'est l'inquiétude que l'homme introduit dans le monde et que l'inquiétude est définitoire de l'humanité, comment y échappe? Y échapper, ce serait se suicider (pour qu’il repose en toi ? = réservé aux croyants).
Y a-t-il une réponse humaine à cette question de la croyance et de l’incertitude ? C'est là où se situe le pari au sens pascalien, le pari transcendantal. Cependant la spiritualité a généralement été comprise comme le contraire de la “nature“ humaine et si la religion consiste à calmer l'inquiétude, la religion devient alors une entreprise de déshumanisation qui dévirilise. C'est alors, non seulement “l’opium du peuple“ mais c’est la drogue définitive comme une impasse. C’est pour échapper à la certitude que le péché est à mettre au cœur de toute option transcendantale. Mais si l'option transcendantale consiste à nous délivrer de nous-mêmes, il y a d'autres moyens de le faire: la drogue (la consommation) est plus économique, philosophiquement parlant.
b) Errare humanum est
Il faut donc envisager comment, dans une autre perspective scientifique, l'erreur est à mettre au cœur de la culture exactement comme le péché est à mettre au cœur de toute option transcendantale, c'est-à-dire de toute attitude religieuse. Voilà pourquoi on ne peut plus opposer la science et la foi. Actuellement nous sommes en train de vivre une mutation qui transforme la science pour créer des sciences humaines qui prennent en compte l'erreur constitutive de l'homme; mais en même temps nous assistons à une transformation complète des religions quelle qu'elles soient et quelle que soit leur histoire dans la mesure où elles prennent conscience du fait que le péché, toujours condamné, devient condition de salut. Voilà pourquoi il faut parler ici pour la science, de Errare humanum est.
Il faut rendre ici au mot “erreur“ son sens étymologique: l'erreur c'est l’incertitude, c’est l’acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et inversement. Parce que parler de l'erreur en disant que c'est le faux à l'égard d'un vrai, suppose de pouvoir dire où ce "vrai" à été déposé.
Au sens analytique du terme (psychanalyse), l’erreur est appelée le manque. Il faut sans doute décliner plus précisément ce manque. Pour la théorie de la médiation l’erreur, ou le manque, est au cœur même de ce qui fait la culture mais il est décomposé en quatre rationalités sous les noms d'impropriété, de loisir, d'absence (ou de mort comme en psychanalyse) et d’abstinence. Ainsi le manque est introduit dans la totalité de ce qu'est notre représentation, notre activité, notre être et notre vouloir. C’est là où se situe l’erreur et l’incertitude.
Ce manque ou cette erreur tient à la non immédiateté du rapport que l’homme a au monde, c’est la non-coïncidence avec l'étalon de ce qu'on devrait reproduire naturellement. Et, là encore, il s'agit bien d'une contradiction dialectique (nature/culture).
C’est de cette contradiction, de ce manque, de cette erreur que résulte apparemment un accroissement de souffrance. L'animal n'a pas ce problème il a mal, c’est tout car la physiologie ne connait que les terminaisons sensible et douloureuses pas de terminaisons de plaisir. Mais il n'y a pas de doute que l'attitude humaine, en introduisant l'erreur dans la connaissance, ajoute du doute à de l’obscur.
Du point de vue du travail (culturel), par le développement industriel nous ajoutons du danger aux catastrophes naturelles. Aujourd'hui l’homme meurt plus des accidents de voiture, du suicide que des irruptions volcaniques ou des catastrophes naturelles. Autrement dit nous ajoutons du danger au danger naturel.
De même du point de vue social nous ajoutons des conflits politiques à la lutte pour la vie (naturelle). En dehors de la lutte pour la vie, en dehors des conditions de nourriture ou de rut, l'animal est tranquille alors que les humains font des petits conflits à toutes les frontières.
Moralement nous ajoutons de la frustration (qui ne va pas forcément jusque’à de l’anorexie) à une indigence déjà naturelle et nous accroissons la pauvreté. En introduisant l'erreur, le manque, dans le monde, l'homme a l'air d'ajouter de la souffrance à la souffrance. C’est là où se situe le problème de la souffrance et de l’homme qui est son propre tortionnaire dans une servitude volontaire. La culture dépend de l'acceptation positive et libre de cette souffrance-là parce qu’elle n’est pas contrainte.
Le manque ou l'erreur devient l’abstraction et le vide du sensible. C’est ce qui donne au concept une certaine dimension d’illusion (le blabla), au produit sa dimension artificielle, au contrat la possibilité de le “décontracter“, c'est-à-dire de le rendre révocable. Quant à la vertu, elle a toujours quelque chose d'une perte, d'une frustration. Enfin c'est pourquoi la connaissance, l'action, l'entente ou le bonheur ne peuvent pas être du plein.
L’idée que l’on se fait généralement de la vertu (du bonheur) est faussée par la difficulté à introduire le manque positivement et la morale prend ainsi l’allure de l’ataraxie. L’apprentissage de la “morale“ consiste le plus souvent à nous épargner les conséquences des actes qu'on ne nous a pas appris à ne pas poser. Eviter les erreurs n’apprend pas la morale car c’est à chacun de juger de l'usage qu'il en fait, à condition bien sûr qu’elles soient définies.
Les troubles observés en psychopathologie sont toujours des troubles de la fusion, c'est-à-dire de la plénitude. S’ils n’en relèvent pas directement, ce sont des troubles liés au fait de prendre ce qui est vide pour un plein, et à ce moment-là ce sont des troubles de l'autolyse. Autrement dit, dans l'humain, dès qu'il y a plein, il y a trouble. Finalement, il n'y a qu'une maladie de l'homme, l’intoxication. C’est aussi pourquoi la psychothérapie s’appuie essentiellement sur la demande qui constitue un manque heuristique.
c) Felix culpa
Donc les sciences humaines prennent en compte la souffrance et elles la transforment en heuristique, qui est l’inverse d’un plein, ni de savoir (l’érudition), ni d’activité (l’activisme), ni d’être (dépendance), ni de vouloir (addiction). C’est le sens premier du mot problema qui signifie que le problème est plus important que la solution.
Parallèlement à l’heuristique de l’erreur, Félix culpa du point de vue mystique ou religieux, contredit la conception masochiste ou névrotique des religions. Luther dans sa réforme pensait la même chose, mais ce n’est pas une incitation à la débauche, cela signifie que l'agnosticisme devient impossible.
L'agnosticisme était possible dans une conception positiviste de la science (Auguste Comte ou Emmanuel Kant), dans la mesure où la science oppose le certain au pas certain, le rationnel à l’irrationnel. Dans cette perspective le point de vue religieux était rejeté comme irrationnel. mais si les sciences humaines prennent en compte la totalité de l'irrationnel et qu'elles prétendent même que c'est l’erreur, le vide, le manque ou la falsifiabilité qui nous fait penser, agir, être et vouloir, il n’est plus possible d’opposer le religieux à l'humain, la science et la foi, sur la base d'un irrationnel que l'une et l'autre partagent?
Avec la mort de l’agnosticisme il n’est plus possible de se fonder dessus pour opposer la foi à la science sans nécessité de faire le pari pascalien pour autant. Le quiétisme des “espérants“ qui vise l’apaisement de l’inquiétude, n’est plus possible non plus car la visée de l’absence de toute angoisse est équivalente au suicide existentiel et à la perte de tout désir. Il s’agit d’assumer l'erreur comme le péché, c’est-à-dire d’assumer l’erreur non seulement comme condition de pensée, de travail, d'histoire ou de liberté, mais comme condition de salut dans la conversion mystique.
Conclusion
Pour conclure rapidement cette réflexion sur la croyance et la certitude, j’espère avoir montré qu’il y a un changement complet dans l'attitude humaine vis à vis du monde (ce n’est pas ici une conclusion mais une heuristique). Ce changement s’observe dans les expressions de l’opinion et dans une herméneutique du quotidien. Le rapport de pure rationalité qui inclut l’irrationnel, réclame une théorie correcte de la raison qui tient que toute dissociation, tout concept qu’elle formule doivent se trouver pathologiquement attestés et cliniquement vérifiés. La théorie de la médiation a élaboré progressivement un modèle théorique qui a pour ambition de renouveler tout le champ des sciences humaines. Pour plus de précisions sur cette théorie vous pouvez consulter https://www.institut-jean-gagnepain.fr/%C5%93uvres-de-jean-gagnepain/
REFLEXION DU MOMENT
REFLEXION SUR LE RAPPORT ENTRE INFRACTION ET TRANSGRESSION
Saisir le texte ici
20 novembre 2020
Les délits sont des infractions au code comportant toujours un minimum de transgression. C’est pourquoi l’infraction est une transgression pénalisée. Cependant personne n’ignore qu’il y a des tas de transgressions qui ne relèvent d’aucune pénalisation et qui ne sont pas considérées dans le code pénal comme des infractions. Beaucoup de transgressions ou d’actes illégitimes ne sont donc pas pénalisés parce qu’ils ne sont pas illégaux ; mais cela ne les rend pas légitimes pour autant.
Or, beaucoup de gens, et des jeunes en particulier, considèrent que l’on peut transgresser parce que ce n’est pas pénalisé ! Mais à l’égard de qui et de quelle autorité peut-on commettre cette transgression ?
Si l’autorité c’est soi-même, c’est à soi-même de ne pas se le permettre. On n’est pas automatiquement habilité à transgresser un certain interdit parce que le législateur ne le sanctionne pas.
D’un côté, l’infraction ne peut être qu’une transgression pénalisée mais la loi ne saurait en aucun cas autoriser ce qu’elle ne sanctionne pas, ni non plus légitimer un acte du seul fait que l’on peut légalement se donner les moyens techniques d’en épargner les conséquences. (les préservatifs et l’avortement permettent-il de donner libre court à la sexualité ? soigne-t-on les pyromanes en cachant les allumettes ?) Si la sexualité, comme n’importe quel objet de consommation, n’est pas rationnée nous ne sommes pas des hommes.
En fait, la loi ne saurait rien autoriser. Si nous sommes libre nous sommes les seul maîtres de l’autorisation. Nous ne sommes pas « libre de faire ce que je veux ! » comme disent les enfants, mais nous sommes libre de faire mieux pour ne pas aller dans le seul sens de notre pulsion.


